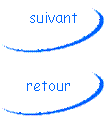|
OUCHCHEN ET BOUMOHAND le début du roman |

|
La demie de cinq heures vient de sonner pesamment au clocher de la chapelle vieille. Debout, face au large éventaire multicolore, Simon Meyral feuillette négligemment une revue. À deux pas derrière lui, du haut des tabourets de bois, des mains s’agitent et des voix se bousculent, troublées par la fuite éperdue d’un lapin entre deux raies de vigne. Les verres tintent sur le comptoir luisant. « Simon, tu fais le quatrième ? » Échappée du brouhaha et des volutes fumeuses de la salle, la joviale question parvient jusqu’au jeune homme. Sans même se retourner, il décline l’invite des joueurs de manille.
Dans le lointain, un bourdonnement régulier chatouille l’oreille, puis s’enfle peu à peu, en un grondement plaintif. Et d’un seul coup, il se relâche, s’apaise en un roulement plus doux ; parvenu au faîte de sa course, peu après la poste, le car de Cavaillon, qui vibrait de toutes ses tôles dans la montée vers le village, se laisse glisser jusqu’à la placette, dans la courbe devant le bar du Philosophe. Et soudain, le gros pied de Martin écrase avec fureur la pédale de frein. Dans un long hurlement douloureux, le vieil autocar s’immobilise enfin devant la porte vitrée.
Prestement les lycéens en jaillissent avec des mines réjouies. Mais le car ne repart pas sur-le-champ, comme à l’accoutumée, dans la descente du lavoir. Il hoquette péniblement de son ralenti essoufflé. Simon relève la tête. Martin n’est plus au volant. Il a sauté lourdement de son siège pour ouvrir une des portes grinçantes sur les flancs de la carrosserie délavée. Avec une courbette cocasse, il dépose deux lourdes valises aux pieds d’une dame à la silhouette altière, toute de noir vêtue et couronnée d’un chapeau également noir.
|